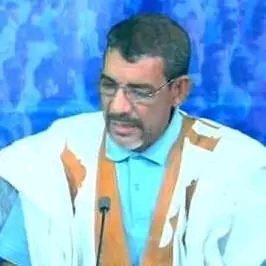Non Cher Frère Lo Gourmo
La langue commune n'efface pas la diversité...elle l'ordonne, la rend intelligible, et la transforme en patrimoine partagé
Cher Frère
L’idée selon laquelle "l’officialisation des langues nationales transformerait le paysage mauritanien en garantissant à chacune de ses composantes une citoyenneté linguistique pleine et entière… " Suscite réaction et mérite examen. Car reconnaître, à côté de la citoyenneté commune, une citoyenneté particulière fondée sur la langue, revient à introduire dans l’édifice républicain un principe de différenciation qui en sape les fondements mêmes. Une telle démarche, loin de renforcer l’unité, en prépare la dislocation en substituant à la communauté civique une mosaïque d’appartenances ethniques, régionales, émirales ou tribales.
L’État-nation, en sa conception moderne, repose sur un pacte unificateur. La Mauritanie, née du consensus d’Aleg en 1958, n’a point été pensée comme un État fédéral. La légitimité de l’État mauritanien s’inscrit ainsi dans la continuité d’une construction républicaine qui, loin de nier la diversité, l’a toujours intégrée dans un cadre unitaire.
La diversité culturelle est l’un des visages radieux de notre histoire commune, nos communautés ont, de tout temps, vécu dans une harmonie fondée sur l’échange, la fraternité, le brassage ontologique et la complémentarité, nos rapports sont si profonds qu’aucune politique, si mal inspirée fût-elle, ne saurait déconstruire.
Hélas, certains parmi nos hommes politiques postindépendance se sont peu à peu détournés de cette harmonie ancestrale, les ambitions personnelles et les intérêts des puissances étrangères ont pris le pas sur la vocation du bien commun…. Le discours politique dérive et se transforme en une machine de discorde qui fait perdre les repères, légitime les excès et justifie les moyens les plus funestes.
Reconnaître à chaque groupe une citoyenneté propre, fondée sur la langue, reviendrait à substituer à l’unité nationale une agrégation d’identités concurrentes. L’État-nation, en sa conception moderne, repose sur la transcendance du particulier par le commun.
La Mauritanie, telle qu’elle fut conçue à Aleg en 1958, n’avait nullement vocation à devenir un État fédéral. Son pacte social, scellé il y a plus de six décennies, consolidé par le référendum constitutionnel de 1991 et des institutions légitimées au fil de l’expérience démocratique, s’inscrit dans la continuité d’un projet républicain unitaire.
Dès l’indépendance, la Mauritanie se distingua dans la région par la précocité de son débat culturel….tous les autres pays ont maintenu le français langue officielle structurante, la Mauritanie doit payer sa velléité dissidente.
Le pays connut des tensions nées d’un schisme idéologique marqué : d’un côté, ceux qui, par fidélité ou par convenance, demeuraient attachés à la langue du colonisateur ; de l’autre, ceux qui voyaient dans la francophonie la survivance d’une tutelle intellectuelle contraire à l’idéal d’indépendance. Pour ces derniers, la liberté ne se conçoit point à demi, elle ne peut être que totale ; le français est l’instrument d’une assimilation insidieuse, la négation même de l’altérité et le prolongement de l’ombre du maître.
Dans les années soixante, à la tribune des Nations unies, feu Sékou Touré voua la colonisation française à l’opprobre par un torrent de verve fulgurante et de sarcasmes mordants.
Le général de Gaulle, informé de cette diatribe par certains de ses collaborateurs, demeura impassible ; un sourire à peine esquissé, empreint de cette ironie tranquille qui lui était coutumière, il laissa tomber, en une formule brève et sans appel, tout un principe de souveraineté : « Laissez-le, il se répond à lui-même ; il parle dans notre langue. »
Ainsi rappelait-il, en une sentence à la fois fière et lucide, que la domination la plus subtile est celle qui s’exerce par la langue, et qu’une langue officielle demeure, à travers les âges, l’un des sceaux les plus sûrs de l’État-nation.
L’histoire des nations modernes corrobore d’ailleurs cette vérité ; La Société des nations, en 1920, tout comme l’Organisation des nations unies après 1945, fondèrent leur légitimité non sur les États, mais sur les nations, c’est-à-dire sur des communautés de culture et de mémoire. L’État, pure construction administrative, ne tire sa stabilité que du socle moral et linguistique de la nation. Ainsi la France, en se retirant de ses colonies, laissa des États mais non des nations, la langue française doit perpétuer la mission des forces d’occupation appelées à regagner l’hexagone…..dix ans plus tard naitra la francophonie pour fédérer les nouveaux Etats indépendants en une organisation satellite de la diplomatie française.
Cet ancrage de la langue comme principe d’unité de la nation française date de très loin ; François 1er, apprenant qu’en certaines provinces du royaume on ne comprenait pas le français, fonda en 1530 le Collège de France pour instruire et unir ses sujets sous une seule langue, la Bretagne deviendra française deux ans plus tard puis Toulon, Brest, en 1558 la France conquit la région de Calais et en 1662 achète Dunkerque ; alors naquit l'hexagone autour de la langue française, il y’en a quand même plusieurs autres langues, écrites et d’envergure internationale…
Partout, l’histoire enseigne la même leçon. En Espagne, malgré onze communautés linguistiques, la Constitution impose en son article 3, la connaissance du castillan à tous les citoyens « le castillan est la langue officielle de l’État, que tous les Espagnols doivent connaître et ont le droit d’utiliser »… En Italie, malgré la coexistence de douze communautés linguistiques, l’italien demeure seule langue officielle de la République. (Loi 482/1999).
Ces exemples attestent que la diversité linguistique peut vivre dans l’harmonie, pourvu qu’elle s’ordonne autour d’une langue commune.
L’argument selon lequel l’égalité statutaire des langues renforcerait la cohésion sociale ne résiste pas à l’épreuve des faits. Nulle part au monde, hormis les trois pays monolingues, Japon, Corée du sud et Islande, un État-nation ne s’est fondé sur la pluralité officielle des langues. L’unicité linguistique est la condition première de l’unité politique.
Cher Frère
Vous prétendez que l’officialisation des langues nationales apaiserait les tensions identitaires. Mais les fractures mauritaniennes, apparues dès 1966, ne furent point le produit d’une domination linguistique de l’arabe ; en 1958, comme en 1966, le français régnait sans partage dans l’administration et l’enseignement, et pourtant, ce fut en ces temps d’effacement total de la langue arabe que naquirent les premières fractures : les démissions des cadres solidaires des grévistes, le manifeste des 19 en janvier 1966 – ancêtre de celui du « Négro-mauritanien opprimé » de 1986 –, la mie à sac des locaux de l’ambassade de Mauritanie à Dakar …. On ne revendiquait alors ni langues nationales ni diversité linguistique ; on défendait seulement le français…..
La langue Pular -puisque c’est bien d’elle qu’il s’agit- si riche et si répandue en Afrique, n’a été érigée nulle part en langue d’État. Ni au Sénégal (23% de la population), ni au Mali (plus de deux millions), ni en Guinée (plus de 40%), ni au Cameroun (plus de trois millions), ni au Nigeria (plus de dix millions), les Halpulars n’ont réclamé l’officialisation de leur idiome. C’est dire que la question linguistique en Mauritanie dissimule, sous des dehors culturels, un enjeu d’ordre politique parfois lié à la relation ambivalente qu’une partie de notre élite politique entretient avec la France.
La reconnaissance des langues nationales, indispensable dans leur dimension patrimoniale, doit se faire sans altérer le principe unitaire de la République ; une langue commune n’exclut pas la pluralité des voix ; elle la rend intelligible et les nations ne se construisent pas sur la juxtaposition des idiomes, mais sur la communion qu’autorise la langue commune.
La vitalité et le rayonnement d’une langue dépendent du degré de développement et de pesanteur mondiale de ses locuteurs ; aujourd’hui, l’anglais domine le monde ; demain le mandarin peut être ; l’arabe est l’exception qui confirme cette règle, langue du sacré et de la mémoire religieuse de près de deux milliards de personnes, conserve une force spirituelle et une vitalité que nul déclin politique arabe ne peut entamer.
Quant à nos langues nigéro-congolaises, elles n’ont point encore les instruments nécessaires pour prétendre à un rôle d’enseignement ; l’expérience sénégalaise le démontre : en 1977, Senghor tenta l’enseignement du wolof (15 salles) et du sérère (01 salle) ; l’expérience tourna court, les classes se referment avant que le Poète-Président ne s’envole pour Paris, où il devait passer le reste de ses jours.
La langue n’est pas seulement un instrument de communication ; elle est la conscience même de la nation, le lien invisible par lequel un peuple demeure un et se reconnaît à travers le temps.
L’histoire nous enseigne que la langue commune n’efface pas la diversité, elle l’ordonne, la rend intelligible, et la transforme en patrimoine partagé ; la nation, pour demeurer fidèle à elle-même, doit continuer de parler d’une seule voix, non pour taire les différences, mais pour leur offrir un espace de résonance.
Je vous remercie
Mohamed oul Radhi
الدكتور محمد ولد الراظي